CRIM-203 : Délinquances juvéniles
La déviance est la « transgression d’une norme acceptée d’un commun accord » (H. Becker)
"Les délinquances juvéniles ne sont donc pas des faits naturels mais le produit de définitions par une société" : processus de désignation relatif relationnel et théorie de l'étiquetage (Howard Becker)
La déviance comme une catégorie construite par la définition du comportement et de la réaction sociale.
Criminalité infantile 19è siècle -> Délinquance juvénile XXe siècle
Enfant =/= Adolescent
Cette représentation de l’enfant est un produit social, le fruit d’une représentation véhiculée par les médias mais aussi de psychologues relativement connus tels que Françoise Dolto et Erikson.
Au XIXème siècle, les principales préoccupations des juges relatives aux délinquances juvéniles sont la prostitution et le vagabondage. Ces délinquances étaient cependant peu véhiculées par les médias, mais il en existe des traces dans les archives de la police. De nos jours, les vagabonds et les prostituées ne sont plus considérés comme des délinquants qu’il faut punir mais davantage comme des victimes qu’il faut aider. Le vagabondage comme délit et répression de « l’errance féminine », (...) On s’attaque alors à la mobilité des femmes sous prétexte de la norme de la "fille sage", "oie blanche". + autorité du père. Fugueuses (+contrôle de la sexualité, prostitution), voleurs et consommateurs arrêtés pour délits prétextes
1960 : Culture typiquement juvénile : Blousons noirs (années 50-60) : émergence de bagarres, vols et remarque sur leur accoutrement
Montrée des vols en 1960 : conséquence de l'industrie, société de consommation : augmentation de la pression par le biais de publicité et médias qui incite à consommer et posséder des biens (les jeunes considérés comme un groupe économique autonome, et donc public cible). + augmentation des biens en circulation + augmentation des occasions de voler (+ émancipation de la femme + obligation de l'école pour enfants = maison vide = opportunité de cambriolages)
1980 : Ethnicisation de la délinquance juvénile : crise structurelle : Conflits politiques et immigrations, des jeunes résident dans des quartiers populaires. Provoque des tensions de quartier, sentiments d'appartenance et groupes, conflits et bagarres, menaces et guerre de territoires. La jeunesse reflète une menace pour l'ordre civil.
La transformation rapide des modes de vie impacte fortement les rapports entre les générations (jeunes et vieux) avec les nouvelles technologies.
Famille = dimension raciale et identité = Clans = Honneur (image et statut = respect)
Tentative de censure de la culture jeune car crainte que les jeunesses renversent le pouvoir établi (mai 1968 et mouvements estudantins et universitaires)
Avec "l'allongement de la jeunesse" qui est dû à la massification des études (les jeunes restent plus longtemps entre eux à l'école et se fréquentent), un recul de l'entrée du monde du travail et un enrichissement de la société dans les années 1950-1960 "Golden Sixties", les jeunes ont désormais du temps libre pour vivre leur jeunesse.
La culture jeune est une affirmation d'une liberté après l'exploitation des jeunes dans l'industrialisation et de l'interdiction du travail des enfants et l'obligation d'aller à l'école.
La jeunesse peut être une figure qui représente le progrès et l'espoir, comme au contraire, il peut représenter la menace, le danger.
Constance dans la volonté de contrôler les corps et la sexualité des jeunes filles : socialisation genrée et pression sociale, dispositions particulières. Enfermement des filles.
Autonomie des femmes après la guerre = industrie à besoin de main d'oeuvre = Travail des femmes, car hommes morts aux affrontements. = Importants changements socio-économiques.
Mai 1968 : Place au féminisme, maîtrise et affirmation d'une égalité entre les genres.
(De nos jours, le corps féminin reste malgré tout un objet de normalisation. Dans Mauvaises filles, incorrigibles et rebelles, Véronique Blanchard et David Niget évoquent l’impact de la socialisation genrée et de la pression que subissent les jeunes filles, qui conduisent parfois à des violences retournées contre elles-mêmes telles que la scarification, la consommation de stupéfiant ou encore l’anorexie. Le corps féminin est toujours beaucoup contrôlé et fortement médiatisé, véhiculant ainsi un modèle féminin de la minceur voir de la maigreur et entraînant ainsi des comportements autodestructeurs qui touchent le corps des jeunes filles.)
__________
Contrôle social : ensemble de moyens et de pratiques qui visent à la conformité des comportements aux normes en vigueur, qui veille constamment au respect de celles-ci.
- contrôle social interne (=auto-régulation) et externe
- contrôle social externe : formel (contrôle et réaction sociale par la société) et informel (réaction sociale par les relations externes)
Dispositifs de contrôle social (M. Foucault) sont un ensemble de discours et de non-dits ayant un mode de gouvernance stratégique basé sur un rapport de pouvoir dont le but est de faire régner l'ordre, de maintenir une certaine stabilité en contrôlant les corps et les esprits.
La jeunesse vulnérable au contrôle, suspicion basée sur leur apparence ou critère d'ethnicité = profilage ethnique.
Institutions répressives, sélectivité de la police sur une jeunesse définie "menaçante"
Davantages de contrôles et de surveillance dans les quartiers populaires que dans les quartiers calmes : ciblage
Les contrôles policiers n'ont aucun impact sur la prévention de la consommation de drogue, le traquage des consommateurs ne permet pas de diminuer la consommation. La politique criminelle se concentre sur certains types de comportements délinquants, les "priorités" et par conséquent, délaissent d'autres crimes.
L’essor du contrôle social formel est dû au fait que, par exemple, plus nous sommes en sécurité, plus nous réclamons cette sécurité et ainsi demandons un contrôle social qui l’assure. (ex : la famille est désormais intégrée dans les normes de l'état qui développe une justice de protection familiale et condamne les violences conjugales)
Le sécuritarisme est un contrôle social et politique établi pour maintenir l'ordre sur base d'une opinion fondée de la peur et par le déploiement de force de l'ordre et de dispositifs de contrôle.
L'intensité de la peur provoquée par les médias est à mettre en rapport avec les informations exposées au public = Y a t-il une stratégie politique mise en place ?
La société de contrôle par les technologies est un état où les moyens de surveillance sont établis, notamment par des opérateurs informatiques qui traitent et analysent les comportements et données. Cela mène à la construction d'un état "smart city", ou "ville connectée" par l'usage quotidien et important de la technologie. Par exemple, le téléphone est un agent communicationnel qui produit des données exploitables pour de potentielles décisions politiques.
___
Réaction sociale : institutionnalisée et codifiée. La délinquance renvoie à la part des déviances retenues par le code pénal et sanctionnées comme telles.
L’adoption d’un comportement (1) par un individu (2) et l’existence d’une norme qui le prohibe (3). En conséquence, on peut affirmer qu’il n’y a pas de déviance en soi, qui existerai en tout temps et en tout lieu.
_______
Les normes sont des modèles de conduites, des obligations et des interdictions fondées sur des valeurs.
Les valeurs sont des idéaux, des fins à atteindre (justice, vérité, équité…) caractérisées par leur polarité.
Selon E. Durkheim, la cohésion sociale repose sur l’adhésion à des valeurs communes, partagées.
Les normes sont plurielles (normes formelles et informelles) et relatives (temps et espace)
La transgression d’une norme formelle donne lieu à une sanction qui aura été codifiée au préalable (amende, peine) : par exemple, dans le code pénal.
Sociocratie : pression horizontale (entre adolescents) afin de s'intégrer.
Socialisation : l’intériorisation des normes de la société
______
Les délinquances juvéniles ne sont donc pas des faits naturels mais le produit de définitions par une société.
Intériorisation d'une norme et activation de la valeur partagée qui opère le processus de socialisation (cohésion sociale, E. Durkheim)
_______________
La « délinquance juvénile » une catégorie spécifique :
Modèle de justice protectionnelle (aide, correction et rééducation), contrôle sur les jeunes et ordre public, enfants comme êtres influençables (soignable et rééducable), enfant influencé par son environnement et donc pas considéré comme responsable de ses actes avant 18 ans.
1) Raisons sociales : le nombre de délit en fonction de l’âge forme une courbe de Gauss qui s’étend en grande partie entre 12 et 25 ans et dont la pointe se situe entre 16 et 17 ans. Les pratiques délinquantes sont donc pour la plupart juvéniles et disparaissent avec l’âge.
Être délinquant à l’adolescence est normal, c'est un phénomène qui existe dans la société et qui est relativement stable.
2) Raisons institutionnelles : La société développe des systèmes juridiques (juridiction d'expertise : acteurs tels que psychologues, assistants sociaux, éducateurs...) spécialisés pour les mineurs, différents de ceux des adultes : car en principe on ne veut pas punir l’enfant mais le traiter = protéger.
Le but étant de lui apporter une aide, de le corriger, et non pas de le sanctionner. Car méfaits de la prison sur l'enfant.
Crainte des jeunes délinquants et du renversement du capitalisme : traiter les jeunes pour le contrôle et ordre public.
Mais cette volonté de traiter le jeune délinquant et non pas de le punir n’est pas seulement philanthropique : on veut discipliner les jeunes car on craint les jeunes errants dans les villes. Les classes bourgeoises avaient peur des jeunes des classes populaires et ouvrières, qu’ils se rebellent et renversent le capitalisme. En effet, au XIXème siècle, on observe une forte préoccupation publique pour la délinquance juvénile en lien avec la révolution industrielle. Cette préoccupation se manifeste notamment à travers diverses considérations morales et hygiénistes à l’égard des classes populaires, sous-tendues par la peur de la « contagion » de ces comportements marginaux à l’ensemble de la population. Ainsi, derrière des idées d’apparence altruistes se cache une volonté de mieux contrôler et corriger les jeunes délinquants afin d’améliorer l’ordre public.
3) Raisons scientifiques : Logique médicalisante. Cause et traitement.
émergence de la médecine, de la psychologie, de la criminologie et de la sociologie, qui proposent toutes des théories étiologiques relatives aux comportements des jeunes délinquants sous des angles différents.
La sociologie des enfants va quant à elle considérer qu’il n’y a pas une mais des pratiques juvéniles, qu’il n’y a pas un enfant mais bien des enfants, qui sont différents (selon de leur milieu socio-économique par exemple). La sociologie va ainsi s’attacher à étudier la socialisation, par exemple genrée, et montrer que l’on inculque des valeurs différentes à des enfants différents.
Les données scientifiques sont qualitatives (échantillon représentatif, enquêtes de victimation, enquête de crimes auto-révélés) et quantitative (données compréhensives, étude etho-graphique, culture : récits de vie,...)
La production savante de la psychologie qui va beaucoup influencer le travail social est le concept de « crise d’adolescence ».
Production d'une socialisation différenciée : différence de traitement et de pratiques entre les genres
Construction sociale
Ce qui définit les enfants sont également un ensemble de pratiques : "adulte miniature du Moyen âge" justice rendue de la même manière pour les adultes que les enfants - travail - enfant socialisé au sein de la communauté et non confiné dans la famille. (enfant = avant 7 ans, dépendant de la famille, après 7 ans = indépendant)
- Au Moyen Âge, considération de l'enfant car mortalité élevée.
- À la Renaissance, idée de la famille nucléaire (= père, mère, enfant), "mignotage"
- 17e et 19e siècle : politique éducative = le bon chrétien bien éduqué. Le "souci moral". L'état et l'église oeuvrent pour encardrer et moraliser la jeunesse.
____
D’une socialisation communautaire à un confinement dans la famille et dans l’école.
Modèle de famille nucléaire fermé > enfant devient objet des attentions, est protégé > enfermement dans la famille = confinement > surprotection > retarde le passage à l'âge adulte
L' objectif : volonté de la famille d'éduquer ls enfants pour qu'ils réussissent socialement.
____
Selon Durkheim, la société et ses institutions s’imposent à nous et tout leur contenu social s’imprime sur nous. Ainsi, nos pratiques sont le produit de notre milieu social (par exemple nous avons un habitus, c’est-à-dire une manière d'être, une allure générale, une disposition d'esprit propre à notre milieu social selon Bourdieu)
Phénomène d'instruction de masse : processus de scolarisation obligatoire et gratuite = enjeu politique et idéologique = école.
L’enseignement de masse obligatoire est censé préparer, conditionner les enfants pour les exigences futures du travail. L'école transmet certains codes en adéquation avec les valeurs du système scolaire et sociétal, et les étudiants sont évalués par des standards de base des classes dominantes. Il y a une responsabilité étatique liée aux politiques publiques, une volonté de "prévenir" la délinquance. Plus l'école produit de l'échec, induit des inégalités sociales et provoque de l'exclusion, plus elle augmente le risque de certains jeunes de basculer dans une trajectoire déviante.
Obligation d'aller à l'école = crée une norme qui crée une déviance en contre-poids.
Le côté optimiste de l’école marche également, mais un peu moins bien : l’école est gratuite et sert donc à démocratiser la société. Cette démocratisation de la société par l’école vient de la Révolution Française et est fondée sur un postulat implicite selon lequel qu’en rendant les individus plus instruits on les rend meilleurs et a pour but de supprimer les inégalités entre les classes.
! Ecole émancipatrice vs lieu d'enfermement et de reproduction les inégalités sociales de l'ordre établi. Reproduit l'ordre social, écarts entre "bons" élèves et "mauvais élèves".
- Soumission de tous les enfants d'une même classe d'âge à une même obligation = norme d'intégration sociale.
- Intrusion de l'Etat dans la famille
Ségragation et apartheid scolaire : Les écoles concentrent certains types de jeunes issus d'une certaine classe socio-économique et ne permet pas la diversité. La mixité sociale et l'égalité des chances sont limitées et les difficultés se concentrent sur les mêmes élèves qui sont regroupés entre eux dans un certain type d'école. Les enfants de familles précaires ne sont pas mélangés avec d'autres enfants de classes sociales, la mixité sociale n'est pas encouragée. Certains enfants ne sont également pas encouragés à réussir car on leur faire croire que l'école n'est pas faite pour eux.
L'école qui est rendue obligatoire rassemble les enfants d'un même âge dans un établissement et ceux qui ne réussissent pas se sentent exclus du système dès leur plus jeune âge. Il finit par croire que les notes obtenues n'ont pas de sens pour lui et ne correspond pas à sa valeur. Il risque la stigmatisation par ses résultats scolaires et est évalué par les standards de la classe moyenne dominante. L'école devient pour lui une souffrance et une source de dévalorisation qui reproduit les inégalités sociales.
C'est à l'école que l'inscription sociale se marque fort et pour beaucoup, de manière définitive. C’est à l’école que se joue le destin personnel de beaucoup de jeunes qui en prennent progressivement conscience
Le phénomène du décrochage scolaire engendre une difficulté à trouver du travail car le marché de l'emploi ne favorise pas l'embauche sans qualification, ni diplôme.
La marginalisation scolaire est un facteur important dans l'adhésion des pôles déviants. Les jeunes qui ne s'accomplissent pas dans le système scolaire tentent alors de s'accomplir ailleurs (besoin de reconnaissance, de valorisation)
Interactions des facteurs d'un pôle déviant : "De mauvais résultats peuvent influencer le climat familial qui peut influencer les résultats scolaire" Les familles précaires peuvent beaucoup miser sur l'école pour que leur enfant réussisse et l'échec scolaire peut être signe de genre déception. Cette pression peut se ressentir sur les jeunes qui vont régir par plusieurs moyens.
La culture de la rue
Les groupes de pairs représentent la troisième sphère de socialisation. Les intérêts d'un jeune se fonde sur des rapports d'inter-influence entre ces groupes sociaux, sur des modèles dits "attirants". La sociocratie qui est la pression du groupe à la conformité ("être comme eux") se manifeste dans cette sphère et le temps passé dans l'entre-soi générationnel est plus long ce qui ancre des fondements dans l'esprit et la vie du jeune.
La culture de la rue possède ses propres voies de valorisation, de normes. La culture de rue renvoie à une caractéristique ancienne des quartiers populaires dans les villes industrielles liées aux valeurs de virilité de la classe ouvrière. (Honneur, reconnaissance, patriotisme, adhésion au quartier, fierté) La culture de la rue est basée sur la réputation. Cette culture permet à certains jeunes à retrouver une estime de soi à travers leur image, et de se forger une identité dans la société.
Une dynamique des sphères de socialisation peut concourir à l'ancrage dans une carrière déviante.
Conversion identitaire : processus psychosocial de rationalisation de l'opposition à un modèle de conformité jugé inaccessible et dévalorisé. Rejet le modèle de conformité et invention de contre-modèles dans le but d'une revalorisation identitaire.
Notion de distinction (P. Bourdieu) : position sociale dans un classement.
Se distinguer des autres classes, montrer son appartenance à un groupe social.
Différences de capital : économique et culturel. Principes d'un groupe social et habitus.
"Les individus de classes moins favorisées tentent toujours d’imiter les pratiques des classes supérieures, tandis que ces dernières tentent de toujours maintenir un écart entre leur classe et les autres." = système d'imitation et de distinction. Tentatives des classes dominées de grimper vers les standards des dominants
Culture de classe et culture jeune : Distinction de certaines familles bourgeoises en inscrivant les jeunes dans des filières qui comprend des élèves de même classe sociales qu'eux...
Inégalités entre les classes sociales et les valeurs des institutions : violence symbolique
Bourdieu considérait l’école comme un moyen de perpétuer l’ordre social dans la mesure où le capital culturel de l’enfant, qui dépend du milieu social dont il est issu, influence sa réussite à l’école, et que le capital culturel des classes dominantes est compatible avec les valeurs prônées par l’institution scolaire, ce qui handicape les personnes issues de classes populaires.
La jeunesse = progrès vs menace à l'ordre !
Mai 1968 : protestation des problèmes institutionnels établis.
Modernité et enfermement généralisé (M. Foucault)
L'école : Traitement différencié enfant et adulte
+ Apprentissage dans un milieu collectif, socialisation (intériorisation des normes, et cohésion sociale)
+ Apprentissage à la maison (=milieu social et familial) influence la réussite à l'école = risque d'inégalités sociales, !! l'explication individuelle ne doit être envisagée qu'en dernier recours
Processus de scolarisation : De l’enfance laborieuse à la jeunesse studieuse :
Société industrielle, travail des enfants, conditions et droits > décret 1813 napoléonien 10 ans travail légal.
Législations vont limiter le travail des enfants et réglementer l'âge d'accès au travail te la durée du temps de travail.
Création d'une classe d'âge spécifique > enfant différenciés des adultes, ce qui extrait l'enfant du travail de la production industrielle + enfants vont à l'école = scolarisation obligatoire = NORME d'assuidité scolaire (et donc déviance = décrochage scolaire, absentéisme)
Certaines personnes, notamment les paysans, ne sont pas très favorables à cette obligation scolaire car elle engendre pour eux une perte de revenus (les enfants travaillaient dans la ferme).
Vacances scolaires : juillet et août, pour que les enfants de paysans puissent aider leurs parents, et vont en contre-parti exiger que les enfants ne soient pas absents plus d’un certain nombre de demi-journées.
Epoque contemporaine : Aujourd'hui, jeunesse studieuse comme modèle dominant.
Diplôme comme qualification /// vs /// marginaux / vagabond / figure anti-sociale
______
Encadrement moral de la jeunesse et dispositifs : engagement, pour limiter l'errance. (ex : service militaire, but instrumental et stratégique), éviter les conséquences néfastes dans la société.
Trois figures négatives de la jeunesse étudiées de la jeunesse contemporaine : le matérialisme (jeune cynique et égoïste), l'insubordination (jeune révolté, impoli), l'oisiveté (jeune fainéant)
La société bourgeoise a peur du désordre, du danger et de l'immoralité.
Mise en place de structures d'encadrement : institutions visant à la discipline.
Valeurs : solidarité et collectivité.
1945 : état social individualiste, pour contrer : mécanisme d'intégration de la jeunesse dans des grands projets collectifs. Car les pères sont absents, conséquence de la guerre. Crise sur le rôle des jeunes sans repères.
La fin du XXème siècle est marquée par une crise économique durable dans toute l’Europe. Les jeunes se retrouvent alors désencadrés par l’une des plus grandes institutions de socialisation, à savoir le travail. Ces jeunes ne sont plus affiliés à un collectif de travail. Il n’y a pas de travail pour les jeunes de classe ouvrière dans ce contexte de chômage de masse. Les jeunes vont alors se retrouver dans un système de formation, d’enseignement, en attente dans les écoles, et y rester pour beaucoup jusque le milieu de la vingtaine. On oblige les jeunes à rester dans cette institution qui n’a parfois pas beaucoup de sens pour eux pour jouer sur les chiffres du chômage et pour occuper les jeunes afin qu’ils ne trainent pas dans la rue.
Ainsi, à la fin du XXème siècle naît une vieille peur du monde adulte accentuée par le vieillissement de la population : la peur que la jeunesse inoccupée et violente s’attaque à des adultes fragilisés. Il y a, à cette époque, un déplacement du point d’équilibre des sociétés vers les personnes âgées : l’état social sécurise les fins de carrières (retraite). Dès lors, les personnes âgées coûtent énormément à l’état social. Mais l’Etat n’a pas sécurisé l’entrée des jeunes dans le monde du travail (ils sont peu aidés financièrement après l’école, restent en attente, ce qui les empêche d’être autonome). L’Etat promet aux jeunes que s’ils respectent bien l’obligation scolaire, s’ils se tiennent à carreaux, ils auront un diplôme et un travail. Mais beaucoup de jeunes sentent qu’il y a une arnaque dans cette promesse, et n’attribuent donc plus beaucoup de sens à l’école. Beaucoup se disent que c’est le moment ou jamais pour s’amuser, ils voient que leurs grands frères ne réussissent pas à trouver du travail malgré leur diplôme, que la promesse de l’Etat n’est pas tenue, qu’ils n’auront pas de moment de gloire, qu’ils ne sont pas reconnus socialement, et donc que leur moment de gloire à eux, c’est maintenant. Certains jeunes trouvent ainsi d’autres voies de valorisation, qui ne sont pas l’école, dans la rue par exemple.
LES AFFRONTEMENTS ENTRE BANDES: VIRILITÉ, HONNEUR ET RÉPUTATION (2009)
Mots-clés : Bandes – Honneur – Réputation – Affrontements – Collectifs.
Guerres vicinales, conflictualité, urbaine, inscrite dans la vie locale
Intense quête de reconnaissance
Affrontements entre groupes juvéniles de différents quartiers
inquiètent l’opinion et les politiques, mise en place d’un « fichier des bandes »
Témoignent du dynamisme et de la détermination des engagements juvéniles dans ces violences en groupe.
significations et finalités
violence utilitaire et acquisitive
+ La mise « sous pression » d’individus ou d’institutions dans le but de jouir d’un pouvoir sur un espace donné, relève d’un autre processus, nous les appelons violences hégémoniques.
+ Les violences émeutières s’inscrivent quant à elles, dans une dynamique de révolte, une logique protestataire et réactive.
+ violences tournées contre des groupes, perçus comme dominants et hostiles et définis par leur altérité sociale, religieuse et/ou ethnoraciale
+ violences qui s’inscrivent dans les logiques d’honneur et de reconnaissance, ce que nous appelons les embrouilles de cité : nous faisons référence aux menaces, intimidations et au échanges de violence, alimentant une conflictualité permanente entre individus et groupes de jeunes, affiliés à différents réseaux et territoires de sociabilité.
+ violences urbaines désigne des conduites variées, dont le degré de gravité est indexé aux menaces qu’elles font peser sur les institutions publiques. (ex : rixe : Querelle violente accompagnée de coups, dans un lieu public)
notion de « territoire »
rivalités honorifiques et rivalités économiques du aux contraintes sociales, politiques et géographiques.
Depuis la révolution des Trente Glorieuses, il y a une transformation des registres de délinquance juvéniles largement dominé par l'appropriation illégale de biens matériels par la crise du à la croissance des classes populaires , la pauvreté, la précarisation du salariat jusqu'en 1980-1990 où la désindustrialisation de la société a touché les populations immigrées, et ouvriers moins qualifiés. C'est dans ces nouvelles figures que les compétitions honorifiques se sont développées.
Les laissés-pour-compte de l'école et du salariat fournissent l'essentiel des effectifs de ces conflits de bandes.
Ces affrontements sont enracinés dans l'histoire et le fonctionnement des territoires. Les jeunes sont porteurs d'une mémoire collective partagée, transmise et régulièrement actualisée.
Implique la "communauté locale", sociabilités publiques
Les conflits sont liés au développement de la société et à la gentrification de la ville, du territoire dans lequel ils ont lieu.
1997 : "La casquette volée"
Conflits graves (coups de couteau, et de feu) dans les écoles en France
1999 : Association locale et collectif de parents s'engagent pour une association commune contre les violences
ZUS : Zone Urbaine Sensible des Hautes-Noues (LHN)
BLB : cité du Bois l'abbé
DCRG : 1991 : Direction Centrale des Renseignements Généraux
DCSP : 1999 : Direction Centrale de la Sécurité Publique
SAIVU : 2002 : Système d’analyse informatique des violences urbaines
INVU : 2005 : Indicateur National des Violences Urbaines
OPAC : Offres publiques d'aménagements et de constructions
Autonomie hors du système de régularisations pénales des "embrouilles"
Persistance d’une conflictualité vicinale (relatif au voisinage ) et vindicative (relatif a la vengeance)
s’appuyant sur des valeurs telles que l’honneur, la réputation et la virilité. Ces valeurs dominantes par le passé, avaient des fonctions communautaires de régulation, elles sont aujourd’hui illégitimes et jugées anachroniques.
Réponse de l'état : contrôles localisés
Peu de plaintes car les belligérants règlent leurs comptes eux-mêmes, les plaintes sont en cas de débordement de troubles publics ou blessures occasionnées
perçues comme un phénomène diffus et périphérique
Conduites qui dépendent grandement de la conjoncture : situation qui résulte d'une rencontre de circonstances
Alliances et rivalités de quartiers
Effectifs de bandes qui autorisent la gestion de plusieurs fronts en même temps : rapport de domination
Volonté de redéfinir les équilibres locaux
Accalmie (=pause dans un conflit) ponctuelle
Questionner la territorialisation des affrontements et des délinquances : Pourquoi y a-t-il des endroits et des périodes plus mouvementées que d'autres ?
Ruptures en matière de transgression (registres des délits, nombres d'engagés, niveau de gravité et de fréquence) intelligible qu'à travers une analyse contextualisée
1. "Histori-cité" : la rue dérégulée.
Mutations importantes dans la sphère des sociabilités juvéniles et dans l'évolution des délinquances entre 1994 et 1999. Ces mutations ont reconfiguré les cadres normatifs des espaces informels de la rue.
+ La « casquette volée » est un événement significatif dont la symbolique n’est pas négligeable. L’action d’humilier par la dépossession, est une atteinte claire et consciente à l’honneur de la victime, mais aussi à ses pairs, lorsque son lieu de résidence est bien connu des agresseurs.
Rupture des modes de régulation intergénérationnelle des comportements juvéniles dans la
cité
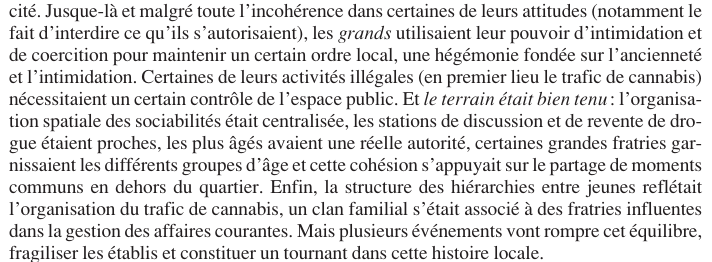 Trafic de guedro, balance qui poucave la mif de l'autre = crée des tensions = conflits
Groupes qui se créent autour de ce conflit
Famille = dimension raciale et identité = clans = Honneur (image et statut = respect)
Conflits qui se déclenchent dans la rue pour "pourrir" l'ambiance ; fait fuir les "non alignés" (= individus externes au conflits mais liés aux relations)
Présence significative féminine
Arrestations qui libère l'espace du marché des stups -> Autres jeunes qui assurent le trafic
Pression, clivage local
Affaire judiciaire de viol collectif en 1997 et 12 incarcérations = dérégulation accentuée
Trafic de guedro, balance qui poucave la mif de l'autre = crée des tensions = conflits
Groupes qui se créent autour de ce conflit
Famille = dimension raciale et identité = clans = Honneur (image et statut = respect)
Conflits qui se déclenchent dans la rue pour "pourrir" l'ambiance ; fait fuir les "non alignés" (= individus externes au conflits mais liés aux relations)
Présence significative féminine
Arrestations qui libère l'espace du marché des stups -> Autres jeunes qui assurent le trafic
Pression, clivage local
Affaire judiciaire de viol collectif en 1997 et 12 incarcérations = dérégulation accentuée
2. Paupérisation et mouvements démographiques
...
crise économique, chômage
Exode rural et nouvelle population de cité
"Les embrouilles", état d'esprit
La participation aux embrouilles traduit des attentes de gratification, une volonté de compenser des échecs, elle reflète l’intériorisation de normes agonistiques et d’un devoir de solidarité
Honneur, dépassement de soi
principe intériorisé
quêtes de statut et de dignité
Honneur-image et honneur-statut: respectabilité
l’honneur est une dimension normative centrale dans l’histoire de la classe ouvrière, ainsi que dans les sociétés
Même si les jeunes n’adhèrent pas à la même vision de l’honneur que leurs parents, cette dernière est un
référent normatif qu’ils s’approprient et qui appuie leur quête permanente de respectabilité
- type de surenchère possède
un terme largement utilisé par les jeunes concernés: le truc de ouf (truc de fou). Mais
le ouf d’aujourd’hui n’est pas forcément déviant, ni forcément membre d’une bande. Le
ouf est l’auteur du dépassement, le leader en cas de tensions. Il permet au groupe d’aller plus loin, de dépasser le statu quo.
La réputation est un objectif social et symbolique qui vise à multiplier les opinions favorables et à produire de la notoriété
La recherche de réputation est une quête de statut social traduisant des attentes de reconnaissance au cœur de nos sociétés.
il existe différents registres de performances : Bagarre, sport, scolarité, séduction, «bizness», «intelligence», apparence vestimentaire… la liste n’est pas exhaustive, mais elle suggère de ne pas considérer l’aisance dans l’affrontement comme le seul créneau de gratification.
Il existe plusieurs manières de faire parler de soi.
Voies d'accomplissement - Reussite et prestige - Mécanisme concurrentiel - Terrain d'affirmation privilégiée - Dépassement sans modération - Excès - Problématique de l'excellence dans une société élitiste - Transgression des normes - Dimension collective - Alternatives aux contre-performances sociales - Estime de soi - Signification
Les actes ne se valent que par ceux qui les reconnaissent.
Faire l'expérience de don existence
Répondre aux offenses.
L’honneur et la quête de réputation rendent ainsi intelligibles les motivations des participants aux affrontements.
La proximité géographique et le rapport au territoire sont donc un enjeu crucial.
L’enracinement résidentiel n’est donc pas le critère ultime de définition des bandes.
- Bandes de quartiers
- Bandes mixtes - sorts d'appartenance (classe sociale, idéologie, histoire, origine...)
Principes unitaires
Représentativité de ces différentes formes de bandes sur le territoire national. La surexposition médiatique et la réactivité des pouvoirs publics concernant les affrontements.
Rapports de presse locale
Le poids des bandes de quartier ait considérablement crû ces trente dernières années sous la pression de la dégradation sociale. Cette précarisation des conditions de vie s’est par ailleurs accompagnée d’un renforcement de la ségrégation urbaine et scolaire (Felouzis, Liot, Perroton, 2005; Maurin, 2004; Van Zanten,2001)qui a accentué la tendance au repli des bandes sur leur quartier.
Développement depuis environ quinze ans de la prévention situationnelle, marquée par le renforcement de la surveillance humaine (moyens policiers, dispositifs de sécurité privée) et technologique (vidéosurveillance) dans les centres urbains très fréquentés, a eu des effets sur les conditions de mobilité des bandes de jeunes.
Les nouvelles contraintes appellent de nouvelles méthodes : descentes lors de rassemblements festifs, présence ponctuelle,...
Jeunesse pistée
Rapport au territoire, approche normative, attachement à un espace central au nom d'expériences individuelles et collectives positives
Territoire identitaire avec ses codes
, ses langages, ses solidarités, son histoire et sa pluralité culturelle
Attachement et appartenance à une communauté locale
Estime de soi
Affrontements, démarrer un contentieux Naissent de contacts directs, fréquence des rencontres
- L'espace local et régional des réputations
Pour que des gratifications aient du sens et qu’elles stimulent, cela suppose l’existence d’un accord collectif sur la valeur des actes, sur les modalités de hiérarchisation des conduites, ainsi qu’un système de circulation et de validation des informations.
La description des modes de communication et d’évaluation est centrale
Les enquêtés font référence à cet espace des réputations pour s’autoévaluer au moyen d’un jeu permanent de comparaisons. Son autonomie relative le rend opérant même en période d’amélioration sociale. Son informalité, sa fluidité et sa fragmentation en multiples réseaux réduisent l’éventualité d’un contrôle.
Si les bandes recyclent les désillusions scolaires et économiques, cet espace des réputations offre un cadre informel stimulant
flux - interconnaissance - "faire parler de soi"
- Aménagement du territoire
Les noeuds de circulation sont des espaces fréquents de tensions
La distribution géographique des centres commerciaux et l’origine spatiale des jeunes qui les fréquentent permettent également de saisir l’effet concret de ces contraintes. Ce sont des lieux animés, généralement peu éloignés des zones résidentielles, qui offrent tous les objets de loisirs et de consommation. La fréquentation des centres commerciaux dépend
de l’état des relations entre les cités situées à proximité. La coexistence pacifique n’existe
pas (ou rarement): soit il existe une sorte de diplomatie informelle qui relève de l’alliance des forces ou d’échanges économiques, soit le terrain est abandonné au profit d’un clan, soit l’état de tension y est permanent.
Les maisons d’arrêt ont de ce point de vue une place particulière : lieu de construction et de validation par excellence des réputations, les prisons sont aussi un lieu privilégié de structuration d’une «élite déviante». En effet, les actions criminelles et les «gros coups » sont des conduites typiques permettant d’acquérir ses « lettres de noblesse » et de postuler à la promotion cooptée dans la division supérieure.
-Lieux sensibles
Stratégies de contournement, territoires ennemis
Lieux interdits et autorisés, hostiles ou sécurisants
Cité adverse, conflits, potentiel de mobilisation,
L'intrusion comme transgression insupportable : un manque de respect.
"Ouais, c’est plus grave, c’est un manque de respect, ça c’est très très grave ! Franchement c’est très grave, n’importe qui te le dira, c’est très grave là, c’est déconné, c’est très très grave ! C’est vrai en plus, quelqu’un qui veut t’embrouiller en dehors, en dehors de ta cité tu vois, tu vas avoir la haine contre lui, tu vas le frapper, tu vas taper le type, mais ça serait pas aussi grave que s’il venait jusqu’à ta cité pour t’embrouiller. C’est très grave, c’est comme si t’es chez toi dans ta maison, le mec il sonne à ta porte, qui vient… il veut se battre avec toi, tu dis mais il se fout de moi, il se fout de moi lui, il vient me chercher devant ma porte, mais il m’a pris vraiment pour sa… pour quelqu’un qui n’a rien à voir quoi, il m’a pris pour une pute "
Les métaphores utilisées sont signifiantes. Venir jusqu’à la maison signifie marquer le mépris et l’humiliation que l’on veut faire subir. C’est violer l’intime. La métaphore sexuelle est ici parlante pour ce qui est considéré comme une violation de l’honneur, un viol du territoire.
- Réputation.com
Le développement d’Internet n’a pas bouleversé l’organisation normative des affrontements entre bandes, il a par contre offert de nouvelles modalités de communication. Tout d’abord en créant de nouveaux espaces d’échange, de confrontation et d’élaboration des réputations. Ensuite, en accroissant considérablement la visibilité des belligérants, enfin, en permettant une scénarisation collective et contrôlée des images du « nous ».
- Les "coups de pouce" de la presse...
La presse occupe une place particulière dans ces compétitions honorifiques
Les médias sont décris comme une fenêtre sur le monde. Le problème est que certaines personnes pensent que les médias sont un miroir sur la vraie vie, alors qu’ils véhiculent une image totalement déformée de la criminalité.
Au plus les médias cultivent la peur du crime, au plus ils favorisent un populisme pénal, c’est-à-dire une culture régalienne, en faveur d’une police, de solutions carcérales, d’un durcissement de la réponse pénale, qui favorise l’autoritarisme et l’intolérance face aux minorités.
Les positions de prestige et les représentations s’appuient sur des mises en images sensationnalistes des banlieues et les récits de la presse écrite. Les médias locaux et nationaux sont des relais efficaces et prisés par les prétendants aux meilleures réputations.
Un reportage en prime-time à la télévision est synonyme d’entrée dans la « cour des grands » (là c’est jackpot)
- Acteurs, mobilisation et solidarité
Protection "communautaire"
Appartenance résidentielle
- "Faire genre", les "embrouilles" au féminin ?
Bandes de filles, sections féminines de gangs de grandes tailles
Déviances féminines et publications académiques
Même les plus cailleras des meufs, elles vont pas avec les gars quand ça s’tape (lors des violences). Mais t’inquiète qu’elles se rattrapent avec leur langue après. Elles veu lent tout savoir, elles comptent les points en quelque sorte. Moi, j’étais comme ça, j’vais passer pas pour une sainte, je cherchais à tout savoir, tous les détails, ceux qui ont flippé, ceux qui passaient pour des bonhommes, j’peux t’dire qu’avec nous, valait mieux pas passer pour une baltringue (un peureux) (Julie)
Echanges d'informations, participations informelles
coopération avec des groupes
Activisme féminin efficace
- Cibles idéales et victimes réelles
Investissement dans les affrontement, exposition à des violences graves
Statut recherché "tête d'affiche" comme un objectif prioritaire et donc une cible
Différents et conflits de gangs de territoires
Institutions, écoles et accords entre certains collèges de départements : principe d'échange entre élèves exclus.
- Conclusion
Tensions et rapports calmés, effectif réduit
Offre éducative et associative
Peur de la mort sociale synonyme d'invisibilité
Cette histoire territorialisée vient souvent combler un double vide :
une distance avec l’histoire familiale et avec les mythes nationaux.
La réussite en "embrouille", permet de développer un accès au pouvoir, à la popularité et à se conformer aux injonctions sociales formelles de la société par d'autres moyens, autrement dit, de par la réputation, d'offrir un espace alternatif de légitimité.
Attachement singulier aux valeurs logiques de l'honneur.
Si de nombreux discours tendent à racialiser ces conduites viriles en raison de la participation des jeunes issus de l’immigration, signalons que l’usage belliqueux de la force physique s’inscrit dans une longue tradition nationale.
La culture virile de l’ouvrier et la culture de l’honneur provenant des pays du sud de l’Europe et d’Afrique n’ont pu que se renforcer mutuellement, mais pour quels débouchés ? Jusqu’au milieu des années 970, cette fougueuse virilité pouvait se recycler « naturellement » dans la culture d’atelier (Mauger, 998). Le chômage, la déstructuration de l’industrie usinière et la raréfaction des emplois manuels non qualifiés ont considérable ment changé la donne. Le déroulement de ces « embrouilles » est sensible au changement social. La force physique et la dureté des rapports sociaux s’expriment avec davantage de vigueur là où l’intégration sociale est durablement fragilisée.
Justice protectionnelle : (19 - 20e siècle), institution spécialisée
devient un objet identifié et surtout un problème public.
Défense sociale par la prévention et répression.
Traiter les jeunes par des méthodes scientifiques (logique médicalisante)
- enfance malheureuse : moralement abandonnés, martyrs, victimes, en danger, maltraités
- enfance dangereuse : incorrigible, multirécidivistes, contagion criminelle et culture criminelle
Prise en charge par l'Etat, système opérationnel
Tribunal de la jeunesse, juge des enfants, prisons pour mineurs, institutions spécialisés, professionels de l'éducation
6 caractéristiques :
1) juge spécialisé, accompagnement jusque 21 ans
2) pas de peines, mais mesures indéterminées qui varient en fonction de l'intérêt du mineur
3) le système vise une prise en charge + humaine et + efficace
4) le mineur : être vulnérable, victime du problème qu'il a connu durant sa socialisation. Responsabilité de l'état et de la famille
5) Approche compréhensive par une logique médicalisante : diagnostic, traitement et réinsertion
6) Eviter l'intervention judiciaire car stigmatisante (+ Théorie de l'étiquetage, de H. Becker)
__________
Le tournant punitif :
phénomène des années 1980,
il y a une tendance internationale au durcissement de la réaction sociale à l’égard des pratiques délinquantes des mineurs par l'émergence des politiques néolibérales et de la crise pétrolière.
Les regards des adultes sur les jeunes changent pour devenir + méfiants.
La jeunesse n’est plus perçue comme étant la force du progrès mais comme dangereuse. Dans la plupart des pays occidentaux, les systèmes de justice des mineurs sont poussés par des acteurs politiques à un durcissement répressif, renforcement de l'intervention judiciaire. = augmentation des solutions d'enfermement
Dans la presse : les faits divers alertent d'une délinquance, stratégie des partis politiques. = discours qui contribuent à un durcissement du système.
Etat social > Etat social ACTIF et rationnalité de l'acte (capacité de réflexion)
A l’inverse des discours de 1965, où l’on affirmait que la société était responsable des déviances des jeunes, dans les discours néo-libéraux dans années 80, les jeunes sont considérés comme des êtres responsables de leurs actes qu’il faut donc sanctionner.
"Si tu veux, tu peux" = mais conditions et buts culturels différents + inégalités sociales et le tournant punitif sanctionne par la logique de l'acteur rationnel.
Développement d'un système hybride :
justice pénale, protectionnelle et réparatrice.
punition, guérison, réparation.
+ Les données administratives (polices, tribunaux, administrations) :
Condamnation formelle : comportement défini comme délinquant.
Pas de condamnation, ni de réaction sociale : chiffre noir = comportement non enregistré dans les statistiques = écart entre la réalité et ce qui est déclaré.
Si on veut mesurer la criminalité, on ne peut se fier aux statistiques administratives car ces dernières ne démontrent que l'activité répressive.
Certains délits ne sont jamais rapportés, et donc pas poursuivis. Certaines plaintes ne font pas l'objet d'une enquête et donc classée sans suite. Certaines infractions sont réglées de façon informelle.
Les infractions fiables aux données administratives sont les cas de vols et cambriolages parce que les victimes ont besoin d'un procès-verbal (PV) pour faire valoir leur assurance.
Par ailleurs, on a parfois l’impression que certains délits augmentent, alors qu’en réalité c’est le report de ces délits qui augmente.
Il y a des types de délinquances qui intéresse + les autorités publiques à un certain moment que d'autres, ce qui influence les statistiques.
La mesure de la délinquance à partir de données administratives se heurtent à 4 obstacles :
1) la réaction de la victime et sa volonté à porter plainte,
2) la réaction de la collectivité,
3) l'activité de la police (mécanisme de filtrage, objectifs de la police et proactivité),
4) délits et infractions qui intéressent les autorités publiques (selon l'époque et les tendances)
________
+ Les données scientifiques quantitatives (sondages alternatifs, self-report / délit auto-raporté, enquêtes de victimation) et qualitatives (entretiens, ethnographies, études de traces écrites)
Ces études confirment l'existence du chiffre noir.
De plus, toutes les degrés de la délinquance sont mélangés (d'un consommateur de drogue à un terroriste), ce système de mesure ne représente pas la réelle criminalité ni ses niveaux de gravité différents. La mesure de criminalité est un prétexte pour le discours politique de renforcer la répression ou les moyens préventifs, tels que la surveillance ou le financement de la police.
5 caractéristiques majeures :
1) La délinquance est normale
2) Les pratiques déviantes sont spécifiques (propres aux jeunesses de leur temps, dépend de l'espace de vie des jeunes, des circonstances de vie, de la socialisation genrée, etc...)
3) La délinquance symptôme est liée à des dysfonctionnements neuropsychologiques
4) Délinquance passagère vs 5) systématisée dite "persistante" ou délinquance d'exclusion (s'adonnent à des pratiques transgressives régulières)
Délinquance systémique :
Ce n'est pas l'appartenance ethnique qui pousse à la délinquance mais l'environnement social.
Focalisation de la police et contrôles dans les quartiers populaires de jeunes issus d'immigration, car résistance aux normes sociétales.
Processus d'adhésion à un rôle déviant :
- sphère de socialisation primaire (famille) et secondaire (école et groupes de pairs)
- réaction à la réaction sociale : facteurs de nature psychosociologique, liés à la réaction à l'étiquette qu'on leur colle et à l'intervention des institutions qui les stigmatisent
! les individus ne sont pas complètement déterminés, ils sont aussi acteurs de leurs actions qui provoquent des déterminants. (Si on était tous entièrement déterminés, toutes les personnes des quartiers populaires stigmatisés délinqueraient, or ce n’est pas le cas)
> Nous sommes tous.tes des équations sociopersonnelles différentes et il existe plusieurs formes d'adaptation de l'individu.
Les conditions d'existences précaires et perspectives d'avenir peu favorables sont sujet d'une vulnérabilité sociétale.
Des jeunes sont contraints de rester dans des situations sociales délinquantes dû aux circonstances de leurs vies et construisent leur identité autour d'un rôle en acceptant une trajectoire délinquante qui évolue avec eux.
Déterminisme vs Libre arbitre :
Nous ne sommes jamais complètement déterminés ni complètement libres
+ Acteur rationnel (capacité de réflechir, de peser le pour et le contre d'une action : on considère que l'être humain est capable d'évaluer le poids de ses actes = conscience)
• La théorie des liens sociaux (Hirschi, 1969): considère l'intégration sociale, au plus un individu est intégré socialement, au moins il émet de comportement transgressif car plus nos liens sociaux sont importants et solides, moins l'individu aura tendance à dévier.
• La théorie de la désorganisation sociale, Shaw à McKay (1942) : Remise en question du système sociétal, perte de confiance dans les institutions qui provoque le déclin des valeurs sociétales et la remise en question de celles-ci. Des groupes sociaux se rejoignent suite à ce phénomène et partagent des valeurs communes et des réflexions collectives politique, une cohésion sociétale est renforcée par ces milieux sociaux et la communauté.
• La théorie des sous-culture, Albert Cohen, 1952 : L'adhésion à une sous-culture déviante admet des jeunes à la reconstruction de norme fondées sur leurs propres valeurs qui peuvent être opposé à la conformité sociétale et à la culture dominante.
• La théorie de la tension, Robert K. Merton, 1938.
Au sein d’une société donnée, il y a des buts culturels à atteindre. Il existe des moyens légitimes d’atteindre ces buts, mais qui ne sont pas répartis équitablement au sein de la population. Dès lors, certains membres acceptent les buts que leur société leur assigne (car il est également possible de ne pas les accepter), mais ne dispose pas des moyens légitimes de les atteindre. En conséquence, ils innovent et trouvent de nouveaux moyens d’atteindre ces buts culturels (par exemple de manière illégale, ce qui fait d’eux des délinquants).
• La théorie de la stigmatisation (E. Goffman, 1975) et de la stigmatisation (H. Becker, 1963) : la délinquance liée à la réaction sociale de l'étiquette qu'on lui colle et l'acceptation de cette dernière par l'individu stigmatisé. Les personnes qui subissent une forte stigmatisation on tendance à se rassembler.
"on traite par la police et le pénal ce qu’on pourrait/devrait traiter par le social.", Philippe Mary et le mécanisme de pénalisation du social.
Baisse de la délinquance
Crime drop : à partir des années 1990 : décroissance des crimes, chute de la délinquance qui concerne tous les types de comportements.
Faits qualifiés d'infraction sont en baisse, mais qu'au contraire, les faits des situations de mineurs en danger augmentent.
Hypothèse de la démographie : population vieillissante, baisse de la délinquance.
Hypothèse de l'acteur rationnel : phénomène de la sécurisation et de la surveillance des biens qui réduit le nombre d'opportunité de commission d'un crime et augmente la perception du risque encouru. Techniques et matériel de délinquance moins en moins à la portée des individus délinquants.
Le "target hardening " : cible de plus en plus difficile ) atteindre.
Moins de rentabilité, diminution de l'intérêt.
Provoque un déplacement de la délinquance.
____
L'espace d'internet et les réseaux :
Modalités de communication, images de soi et raport à l'identité
Peur de la mort sociale = invisibilité
La culture juvénile actuelle est extrêmement liée à la culture numérique.
Phénomène des "digital native" : jeune né avec une position technophile et les idéologies de la communication
Hypothèse de la culture online : Les jeunes passent moins de temps à l'extérieur et naviguent sur les réseaux sociaux chez eux, et cela à un effet sur l'occupation de l'espace public, la socialisation et les rapports aux autres. = déplacement de la délinquance sur le cyberespace. Moins repérable, moins repérés.
A côté de cela, il y a bien évidemment toute une série de critiques, de préoccupations de la part des adultes et des entrepreneurs de moral vis-à-vis de cette nouvelle culture jeune qui apparaît inquiétante. La technologie, internet et les réseaux sociaux ont inquiété et inquiètent toujours certains adultes parce qu’ils auraient une influence néfaste et dangereuse sur les jeunes.
Des critiques apparaissent toujours face aux innovations : on a critiqué la télévision, le cinéma à ses débuts, les comics ont été stigmatisés et censurés aux Etats-Unis, les SMS ont été fortement critiqués à une époque parce qu’on pensait que les jeunes ne sauraient plus écrire.
Le jeune a besoin de s'affilier à un groupe de pair = éviter la mort sociale
Cela correspond à un désir d'indépendance par rapport à leur famille, s'éloigner du contrôle de leur parents.
Internet permet cette approche sociale et de satisfaire ce besoin de reconnaissance, d'autonomie, d'affiliation (appartenance à un groupe) et d'individualité.
Internet peut servir d'exutoire émancipateur comme il peut avoir comme conséquence un enfermement des jeunes dans les mêmes bulles de socialisation (homogamie sociale), c'est-a-dire que les individus d'une certaine classe sociale restent entre eux.
Les bulles de filtre créées par l'algorithme d'une application ont des conséquences d'isolement individuel en confrontant les utilisateurs à des contenus standardisés et adaptés à leurs intérêts reproduits en écho à ce qu'ils connaissent déjà et confirme leur opinions par des biais de confirmation ; cela limite le libre-arbitre et le choix d'explorer la diversité sur le web.
Les réseaux sociaux contemporains sont des moteurs d'émotions bipolaire et exploitent des moyens qui affectent l'humeur et la façon d'être des jeunes.
Phénomène des NEET : "Not in Education, Employment or Training"
Drari : personne du quartier qui a un certain type de langage et comportement
rapport aux valeurs
"les enfants" ou potes, solidarité, fraternité, être quelqu'un, le sang, un bon ami
Mot péjoratif ? délinquance, qui fait des actes de jeunes, un gars du quartier, vie dans la rue, les bandes urbaines
solidarité, sincérité
quelqu'un qui veut s'assumer tout seul
Ce mot peut indiquer une personne seule ou une bande
Mélange culturel
Style et apparence, mauvais garçon
Business
Homogénéité et hétérogénéité
La culture juvénile est homogène (se rapproche par le qualificatif de l'âge) et aussi hétérogène (se caractérise par des jeunesses distinctes et non un seule type de jeunesse)
Les mécanismes de reproduction : notre milieu social va influencer notre vie sociale.
La jeunesse n'a pas une unité = il s'agit de jeunesses qui se développent différemment selon les cultures de leur environnement.
La jeunesse n'est pas un groupe social définit
L'appartenance a une classe d'âge est éphèmere, la notion de jeunesse varie selon les époques et les sociétés.
Les individus sont pluriels et hybrides, ils sont libres de faire des choix et d'avoir des identités plurielles.
Les jeunesses sont les produits de la socialisation : les jeunesses sont des catégories de la population qui sont les fruits d'un processus de socialisation, influencés pas différentes sphères de socialisation (les pairs, l'école, les médias, la famille*, ses gouts, ses pratiques...)
*la famille : socialisation primaire, les autres, socialisation secondaire.
^ transmet le capital culturel.
Les délinquances juvéniles dans le champ politique : Les autorités ont peur de la culture juvénile, de la délinquance et de la révolution (multiples exemples historiques : révolutions estudantines, Révolution française, mai 1968, révolution culturelle en Chine,...) La délinquance juvénile est alors désignée comme dangereuse et néfaste. D'où la politique criminelle mise en place, et des idéologies de "tolérance zero" = l'état va mettre en place des mesures pour limiter les crimes des jeunes.
La délinquance juvénile dans le champ médiatiques : Les médias vont mettre à la une certains faits commis dans une société. Les diffusions d'informations à travers les médias sont comme des fenêtres sur le monde qui ne permet que d'apercevoir une partie de la réalité, de plus que la réalité véhiculée peut être déformée.
Les données administratives
Les comportements condamnées par le contrôle social formel encourent des sanctions pénales.
La pénalité est une réaction sociale face au comportement délinquant.
Les reports ont lieu à un procès verbal enregistré dans les données administratives de l'état qui contribue aux statistiques de l'activité de ceux qui tracent ces données.
Il y a de nombreux cas où les reports n'ont pas lieu, ou le fait est classé sans suite, et donc non considéré par l'état. On appelle cela le chiffre noir de la criminalité.
Les statistiques policières ne représentent pas la criminalité mais l'activité de ceux-ci.
La politique criminelle mis en place vise un certain type de comportement délinquant et par conséquent, ces priorités font monter les chiffres des statistiques.
Les données administratives peuvent enregistrer des enquêtes de victimation (permet de mesurer si certaines catégories sont victimes d'infractions), des rapports de délit inexistants (cause une surrévaluation)
Pratiques de délinquances juvéniles : expériences partagées en groupe.
- consommation (comme "auto-médication", possible), vol, cyber-harcelement... => conséquences de la société de consommation, par la possession d'objets et des buts culturels de la société (buts à atteindre pour s'intégrer = sociocratie), érigés par les valeurs sociales.
Les inégalités sociales pèsent et ont des effets psychologiques
Il existe plusieurs pratiques de délinquances juvéniles dites "normales" et "spécifiques"
1) Les pratiques passagères = temporaires.
Se caractérise par l'expérimentation, l'influence, la recherche de plaisir
Les adolescents sont des êtres déterminés par des contraintes et sont dotés d'un libre arbitre.
Ils passent par un processus de socialisation, le développement de l'être humain en société.
C'est un comportement hors de portée de l'autorité politique = il est impossible d'interdire l'adolescence ! (il ne faut pas condamner les comportements, mais les expliquer par la prévention = réduction des risques)
2) La délinquance symptôme : trouble mental, comportement clinique et psycho-médical
3) La délinquance systémique : Acceptation d'une attitude délinquante, d'un mode de vie qui transgresse les normes.
Conséquence de la précarité / vulnérabilité sociétale, de l'exposition à la violence.
Tout adolescent souhaite s'ajuster aux buts culturels de la société, par tous moyens, car ils sont exposés à la vie dans un environnement normé contemporain.
Construction d'une identité délinquante, justifiée et raisonnée = neutralisation de la culpabilité. à la place de la "mort sociale" 💀
La vulnérabilité est un facteur qui favorise un comportement déviant. Mais n'est pas forcément un déterminant de la déviance (il y a des jeunes vulnérables qui se débrouillent sans avoir recours à la délinquance)
Le rapport à la société de consommation dans les délinquances
"Crime drop" 1940 - 1990 : car hausse des délinquances, provoqué par la production de masse et mise en circulation de biens, ce qui incite les jeunes à posséder et parfois à voler pour s'ajuster aux buts culturels de la société de consommation.
1990 : Baisse de la criminalité, diminution globale des faits qualifiés comme infraction (FQI) car politique criminelle et contrôle social formel constant.
Mais hausse des comportement en lien à la dépression et aux maltraitances conjugales.
Evolution de la démographie : Société vieillissante
Une caractéristique du "Crime drop" juvénile : Moins de jeunes et plus de vieux dans nos sociétés, donc moins de délinquances juvéniles.
L'aspiration à la vie "online"
: Les jeunes ont une tendance à utiliser les réseaux sociaux plutôt que de sortir, ce qui a une conséquence sur leur mobilité et visibilité dans les espaces publics.
Il y a un déplacement de la criminalité (piratage, fraude, etc...)
Entraînement à l'examen : here
+++ Raisonnements et argumentations +++ Syllogisme : Raisonnement déductif rigoureux qui, ne supposant aucune proposition étrangère sous-entendue, lie des prémisses à une conclusion (ex. « si tout B est A et si tout C est B, alors tout C est A »). Tautologie : thèse reformulée et utiliser comme argument (vrai par définition) Pétition de principe : faute logique, raisonnement circulaire, par laquelle on considère comme admis ce qui doit être démontré. Paralogisme de généralisation : mettre tout dans le même panier Paralogisme de composition : erreur de raisonnement involontaire qui consiste à attribuer à un tout une propriété qui n'appartient qu'à ses parties. Argument ad hominem : disqualification de l'émetteur de la thèse Sophisme : argument faux malgré une apparence de vérité Raisonnement causal : établir un lien entre une cause et un effet, permettant d'expliquer des phénomènes, nécessite des preuves empiriques pour démontrer un lien direct entre les événements Raisonnement par analogie : établir une correspondance entre une situation ou un concept connu (source) et une situation nouvelle ou inconnue (cible) afin de comprendre cette dernière Appel aux chiffres ou aux données concrètes Procès d'intention Argument d'autorité
+++ Figures de style : Prétérition : consiste à annoncer ce qu'on ne va pas dire Métonymie : remplacement Synecdoque : (forme de metonymie) - particularisante - généralisante Métaphore =/= comparaison description illustrée, rapprocher deux réalités par un lien, exercice imaginatif par l'image Oxymore : Conbinaison de deux elements antagonistes/contraires Hyperbole : Exagération Euphémisme : atténuer une réalité difficile Litote : "on ne veut pas dire le mot" Périphrase : former une phrase pour er éviter la répétition +++ Figures de styles syntaxiques : Enallage : originalité grammaticale, emploi de l'imparfait Chiasme : figure de croisement de deux groupes de mots Hypallage : Attribuer un mot à un autre Asyndète : Juxtaposition de deux phrases sans mot de liaison Zeugme/Attelage sémantique : Placer sous la dependance d'un mot deux termes qui ne sont pas compatibles +++ Figures phonétiques : Assonance (voyelle) Allitération (consonne) Homéotéleute (rhyme en prose) Cacophonie Calembour Paranomase (similarité phonétique) Néologisme

 Sommes-nous tous victime d'un système qui commet des actes délinquants ?
Réponse à une question : "Ceux qui veulent "profiter" du système sont en fait des personnes en demande."
Réhumaniser par les forces sociales
FQI : Fait considéré infraction
TAP : Tribunal d'application des peines
RAJ : Réseau d'Aide et Justiciable (service externe du milieu carcéral belge)
SPS : Service psychosocial des établissements pénitentiaires belges
CP : Code Pénal ou Congé pénitentier (lexique carcéral)
PS : Permis de sortie (lexique carcéral)
TCR : Théorie du chois rationnel
COCOF : Commission communautaire française
SAJP : Système d'Administration de la justice pénale
Sommes-nous tous victime d'un système qui commet des actes délinquants ?
Réponse à une question : "Ceux qui veulent "profiter" du système sont en fait des personnes en demande."
Réhumaniser par les forces sociales
FQI : Fait considéré infraction
TAP : Tribunal d'application des peines
RAJ : Réseau d'Aide et Justiciable (service externe du milieu carcéral belge)
SPS : Service psychosocial des établissements pénitentiaires belges
CP : Code Pénal ou Congé pénitentier (lexique carcéral)
PS : Permis de sortie (lexique carcéral)
TCR : Théorie du chois rationnel
COCOF : Commission communautaire française
SAJP : Système d'Administration de la justice pénale
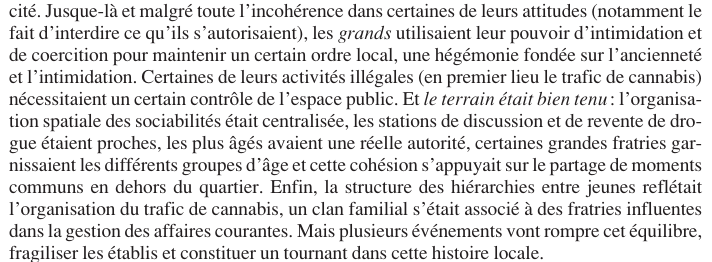 Trafic de guedro, balance qui poucave la mif de l'autre = crée des tensions = conflits
Groupes qui se créent autour de ce conflit
Famille = dimension raciale et identité = clans = Honneur (image et statut = respect)
Conflits qui se déclenchent dans la rue pour "pourrir" l'ambiance ; fait fuir les "non alignés" (= individus externes au conflits mais liés aux relations)
Présence significative féminine
Arrestations qui libère l'espace du marché des stups -> Autres jeunes qui assurent le trafic
Pression, clivage local
Affaire judiciaire de viol collectif en 1997 et 12 incarcérations = dérégulation accentuée
Trafic de guedro, balance qui poucave la mif de l'autre = crée des tensions = conflits
Groupes qui se créent autour de ce conflit
Famille = dimension raciale et identité = clans = Honneur (image et statut = respect)
Conflits qui se déclenchent dans la rue pour "pourrir" l'ambiance ; fait fuir les "non alignés" (= individus externes au conflits mais liés aux relations)
Présence significative féminine
Arrestations qui libère l'espace du marché des stups -> Autres jeunes qui assurent le trafic
Pression, clivage local
Affaire judiciaire de viol collectif en 1997 et 12 incarcérations = dérégulation accentuée